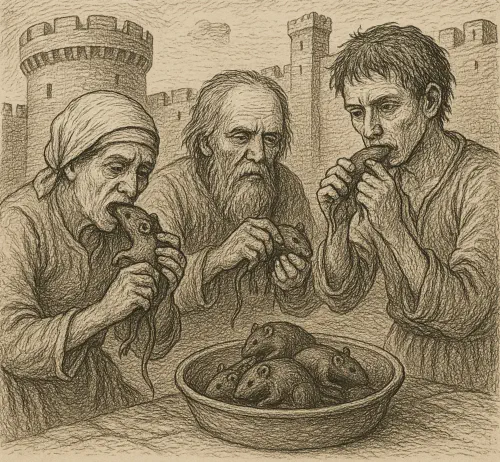Histoire du siège de La Rochelle et l'implication de Richelieu
Le
siège
de
La
Rochelle
constitue
l'un
des
événements
militaires
et
politiques
majeurs
du
règne
de
Louis
XIII
et
illustre
parfaitement
la
montée
en
puissance
de l'absolutisme monarchique en France.
Durant 14 mois, entre 1627 et 1628, cette cité portuaire protestante a résisté aux forces royales dirigées par le Cardinal de Richelieu.
Contexte historique et situation de La Rochelle avant le siège
Au
début
du
XVIIe
siècle,
La
Rochelle
s'impose
comme
une
puissance
singulière
dans
le
paysage
français.
Avec
ses
28
000
habitants,
dont
18
000
protestants,
elle
représente
bien
plus
qu'une
simple
ville
portuaire prospère.
La
cité
constitue
le
dernier
grand
bastion
huguenot
(protestant)
dans
un
royaume
majoritairement
catholique,
jouissant
d'une
autonomie
politique
et
militaire
considérable
qui
en
fait
une
véritable
"république dans le royaume".
Cette
position
privilégiée
trouve
son
origine
dans
l'Édit
de
Nantes,
promulgué
en
1598
par
Henri
IV pour mettre fin aux guerres de religion.
Ce
texte
fondamental
garantissait
aux
protestants
des
droits
spécifiques,
notamment
celui
de
conserver leurs places fortes et leurs fortifications.
La
Rochelle
bénéficiait
ainsi
d'un
statut
particulier
avec
ses
remparts
imposants,
son
port
fortifié
et
sa milice autonome, échappant largement à l'autorité directe du pouvoir royal.
La
ville
s'est
progressivement
transformée
en
une
entité
politique
aspirant
à
davantage
d'indépendance.
En
1621,
les
Rochelais
tentent
même
de
constituer
une
"Nouvelle
République"
inspirée
du
modèle
des
Provinces-Unies
(actuels
Pays-Bas),
qui
avaient
réussi à s'émanciper de la tutelle espagnole.
Cette volonté d'autonomie croissante inquiète profondément le pouvoir royal qui y voit une menace directe pour l'unité du royaume.
L'influence
et
la
puissance
de
La
Rochelle
reposaient
également
sur
ses
relations
maritimes
privilégiées
avec
des
puissances
protestantes
étrangères,
particulièrement l'Angleterre et les Provinces-Unies.
Ces
alliances
stratégiques
garantissaient
à
la
cité
un
soutien
diplomatique,
commercial
et
militaire
qui
renforçait
considérablement
sa
position
face
au
pouvoir
royal français.
Son port, l'un des plus actifs du royaume, était le point de convergence d'un vaste réseau commercial international qui faisait la prospérité de la ville.
Cette situation exceptionnelle transformait La Rochelle en un symbole pour tous les protestants français.
Un refuge, une forteresse, et un espoir d'existence libre au sein d'un royaume de plus en plus centralisé et catholique.
Cette
configuration
allait
inévitablement
provoquer
une
confrontation
avec
le
pouvoir
royal,
déterminé
à
affirmer
son
autorité
sur
l'ensemble
du
territoire
français.
Causes du siège de La Rochelle
Le
siège
de
La
Rochelle
trouve
ses
racines
dans
une
conjonction
de
facteurs
politiques,
religieux et géostratégiques qui ont progressivement conduit à cette confrontation majeure.
Au
cœur
de
cette
crise
se
dessine
la
montée
en
puissance
d'un
État
monarchique
centralisateur,
incarné
par
Louis
XIII
et
son
principal
ministre,
le
Cardinal
de
Richelieu,
nommé en 1624.
La rupture de plusieurs traités de paix a également exacerbé les tensions.
Le
traité
de
Montpellier
de
1622,
qui
devait
garantir
une
coexistence
pacifique,
n'a
jamais
été pleinement respecté par les deux parties.
Les
protestants
ont
maintenu
leurs
fortifications
tandis
que
le
pouvoir
royal
a
continué
de
limiter lentement leurs privilèges.
L'intervention anglaise constitue l'élément déclencheur direct du siège.
En
juin
1627,
une
flotte
anglaise
commandée
par
le
duc
de
Buckingham
débarque
sur
l'île
de
Ré,
à
proximité
immédiate
de
La
Rochelle,
dans
l'intention
de
soutenir les protestants français.
Cette intrusion étrangère sur le sol français pousse Richelieu à réagir avec fermeté.
Il y voit l'opportunité de régler définitivement la "question rochelaise" tout en affirmant la souveraineté française face aux ingérences étrangères.
"Il faut couper la tête du dragon plutôt que de s'attarder à combattre chacun de ses membres."
Cardinal de Richelieu, faisant référence à La Rochelle comme la tête du protestantisme français qu'il fallait soumettre pour assurer l'unité du royaume.
Cette
célèbre
expression
de
Richelieu
illustre
parfaitement
sa
vision
stratégique
:
La
Rochelle
représentait
le
cœur
de
la
résistance
protestante,
et
sa
soumission entraînerait nécessairement celle des autres communautés huguenotes dispersées dans le royaume.
Le
siège
qui
s'annonce
n'est
donc
pas
seulement
une
opération
militaire,
mais
un
acte
politique
fondateur
du
nouvel
ordre
monarchique
que
Richelieu
entend
instaurer en France.
Rôle et stratégie de Richelieu dans le siège
Le
Cardinal
de
Richelieu
se
révèle
être
l'architecte
principal
et
le
commandant
de
facto
du
siège
de La Rochelle, démontrant des talents militaires insoupçonnés pour un homme d'Église.
Dès
septembre
1627,
comprenant
l'importance
cruciale
de
cette
opération
pour
la
consolidation
du
pouvoir
royal,
il
prend
personnellement
la
direction
des
opérations
sur
le
terrain,
un
fait
remarquable pour un ministre de son rang.
L'originalité et la force de la stratégie de Richelieu résident dans sa conception globale du siège.
Plutôt
que
de
lancer
des
assauts
frontaux
coûteux
en
vies
humaines
contre
les
puissantes
fortifications
rochelaises,
il
opte
pour
une
stratégie
d'étouffement
progressif
de
la
ville,
combinant
un blocus terrestre et maritime d'une ampleur sans précédent.
Sur
terre,
Richelieu
fait
construire
une
impressionnante
ligne
de
retranchements
de
12
km
entourant complètement la ville.
Cette
circonvallation
comprend
treize
forts
reliés
par
des
tranchées
et
des
redoutes,
empêchant
toute entrée ou sortie par voie terrestre.
Près
de
25
000
hommes
sont
mobilisés
pour
maintenir
ce
dispositif,
une
force
considérable
pour
l'époque.
Mais
c'est
sur
mer
que
le
génie
stratégique
de
Richelieu
s'exprime
pleinement
avec
la
conception
et
la
réalisation
d'un
ouvrage
exceptionnel
:
une
digue
maritime de 1 500 mètres barrant la rade de La Rochelle.
Cette
construction
titanesque,
considérée
comme
impossible
par
de
nombreux
experts
militaires
de
l'époque,
témoigne
de
l'audace
et
de
la
détermination
du
Cardinal.
Structure de la digue maritime
L'ouvrage était composé de 59 navires délibérément coulés et remblayés pour former une base solide.
Sur cette fondation furent installés des pilotis et des poutres en bois, puis des pierres et des matériaux de remblai.
La
digue
présentait
une
ouverture
centrale
étroite,
surveillée
en
permanence
par
l'artillerie
royale,
rendant
impossible
le
passage
des
navires
de
ravitaillement.
Dispositif anti-navires
En
complément
de
la
digue,
Richelieu
fit
installer
un
système
élaboré
de
pieux
enfoncés
dans
les
fonds
marins,
de
chaînes
tendues
entre
des
flotteurs
et
des
batteries d'artillerie positionnées stratégiquement.
Ces dispositifs rendaient extrêmement périlleux toute tentative d'approche maritime de La Rochelle.
Coordination face aux interventions anglaises
Face
aux
trois
tentatives
de
la
flotte
anglaise
pour
secourir
La
Rochelle
(octobre
1627,
mai
et
septembre
1628),
Richelieu
démontra
ses
talents
de
stratège
en anticipant les mouvements ennemis et en renforçant systématiquement les points vulnérables de son dispositif.
Chaque tentative anglaise se solda par un échec cuisant.
L'implication personnelle de Richelieu dans le siège fut totale.
Contrairement
aux
habitudes
de
l'époque
où
les
ministres
restaient
à
distance
des
opérations
militaires,
il
établit
son
quartier
général
à
proximité
immédiate
des lignes de siège, visitant quotidiennement les chantiers, inspectant les travaux de la digue et motivant les troupes par sa présence.
Cette
proximité
lui
permit
également
de
résoudre
rapidement
les
problèmes
logistiques
considérables
posés
par
l'entretien
d'une
armée
de
siège
pendant
plus d'un an.
Au-delà des aspects purement militaires, Richelieu déploya également des efforts diplomatiques pour isoler La Rochelle sur la scène internationale.
Il
parvint
notamment
à
neutraliser
temporairement
l'Espagne,
pourtant
rivale
traditionnelle
de
la
France,
en
lui
faisant
comprendre
que
l'élimination
du
foyer
protestant de La Rochelle servait aussi les intérêts catholiques espagnols.
"Ce n'est pas aux canons du roi de faire brèche aux murailles de la ville, mais à la faim de faire brèche dans les cœurs et les esprits des habitants".
Cardinal de Richelieu, expliquant sa stratégie d'asphyxie progressive de La Rochelle.
Déroulement et conséquences du siège
Le
siège
de
La
Rochelle
s'étend
sur
une
période
exceptionnellement
longue
de
14
mois,
de
septembre
1627
à
octobre
1628,
éprouvant
tant
les
assiégeants
que les assiégés.
Après l'établissement du blocus terrestre et maritime complet au printemps 1628, la situation des Rochelais devient rapidement critique.
Les réserves alimentaires s'épuisent progressivement, conduisant à une famine d'une ampleur terrible.
Les chroniques de l'époque décrivent avec effroi les souffrances endurées par la population :
"Les habitants en étaient réduits à manger des rats, du cuir bouilli et même, dit-on, les cadavres des morts".
Le
maire
de
La
Rochelle,
Jean
Guiton,
personnage
emblématique
de
la
résistance
rochelaise,
avait
pourtant
juré
de
tenir
jusqu'au
bout,
allant
jusqu'à
poser
un
poignard
sur
la
table
du
conseil
municipal en déclarant qu'il s'en servirait contre quiconque parlerait de reddition.
Aux
ravages
de
la
famine
s'ajoutent
bientôt
ceux
des
épidémies
qui
se
propagent
rapidement
dans une ville surpeuplée et affaiblie.
Le
typhus
et
la
dysenterie
déciment
la
population.
Les
tentatives
de
secours
britanniques
se
soldent par des échecs répétés face à l'infranchissable digue de Richelieu.
La
dernière
expédition
de
secours,
en
septembre
1628,
renonce
même
à
combattre
après
avoir
constaté l'impossibilité de forcer le blocus.
La
ville
finit
par
capituler
le
28
octobre
1628,
après
avoir
perdu
près
de
19
000
habitants
sur
une
population initiale de 28 000 âmes.
Louis
XIII
fait
son
entrée
triomphale
dans
la
cité
le
1er
novembre,
symbolisant
la
victoire
absolue
du pouvoir royal sur la résistance protestante.
Les
termes
de
la
capitulation
reflètent
la
politique
paradoxale
de
Richelieu
:
fermeté
politique,
mais relative tolérance religieuse.
Si
la
liberté
de
culte
est
maintenue
pour
les
protestants
rochelais,
conformément
à
l'Édit
de
Nantes,
leurs
privilèges
politiques
et
militaires
sont
en
revanche
définitivement supprimés.
Les fortifications de la ville sont démantelées, son autonomie municipale abolie et une administration royale s'installe durablement.
Les conséquences du siège s'étendent bien au-delà des murs de La Rochelle.
Pour la communauté protestante française dans son ensemble, la chute de son principal bastion marque le début d'un long déclin.
De
nombreux
protestants
choisissent
l'exil
vers
des
terres
plus
accueillantes
comme
les
Pays-Bas,
l'Angleterre
ou
les
colonies
américaines,
initiant
une
diaspora qui s'amplifiera considérablement après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685.
Pour Richelieu et la monarchie française, la victoire de La Rochelle constitue une étape cruciale dans la construction de l'État absolu.
Le
Cardinal
poursuit
sa
politique
de
centralisation
en
s'attaquant
ensuite
aux
grands
seigneurs
féodaux
et
aux
factions
aristocratiques
qui
contestent
encore
l'autorité royale.
Le prestige acquis lors du siège renforce considérablement sa position auprès de Louis XIII et lui permet de mettre en œuvre ses ambitieuses réformes.
Paradoxalement, c'est aussi à la suite de ce siège victorieux que Richelieu entreprend la création d'une véritable marine royale française.
Ayant
constaté
les
faiblesses
maritimes
du
royaume
face
aux
interventions
anglaises,
il
décide
de
doter
la
France
d'une
flotte
puissante
capable
de
défendre
ses côtes et ses intérêts commerciaux.
L'arsenal
de
Brouage,
proche
de
La
Rochelle,
devient
l'un
des
principaux
chantiers
navals
du
royaume,
préfigurant
le
développement
maritime
qui
caractérisera plus tard le règne de Louis XIV.
Conclusion : importance historique du siège de La Rochelle
Le
siège
de
La
Rochelle
constitue
un
tournant
majeur
dans
l'histoire
de
France,
marquant
symboliquement
et
concrètement
la
fin
d'une
époque
et
l'avènement
d'une
nouvelle
conception
de
l'État.
Cet
événement
cristallise
plusieurs
transitions
fondamentales
qui
façonneront
durablement
le
royaume
et, au-delà, l'Europe moderne.
Premièrement,
le
siège
marque
la
fin
effective
des
guerres
de
religion
qui
avaient
déchiré
la
France
pendant près d'un siècle.
Si
l'Édit
de
Nantes
avait
posé
un
cadre
juridique
pour
la
coexistence
religieuse,
c'est
la
défaite
militaire
du
parti
protestant
à
La
Rochelle
qui
scelle
définitivement
l'impossibilité
d'une
résistance
armée
des
huguenots.
La
pacification
religieuse
s'opère
désormais
selon
les
termes
dictés
par
le
pouvoir
royal,
qui
tolère
le
culte protestant, mais supprime toute dimension politique et militaire du fait religieux.
Deuxièmement,
la
victoire
de
Richelieu
à
La
Rochelle
illustre
parfaitement
sa
conception
de
la
raison
d'État,
qui
subordonne
toutes
les
considérations
particulières,
y
compris
religieuses,
à
l'intérêt
supérieur
du royaume et à l'autorité du souverain.
En tant que cardinal de l'Église catholique, Richelieu aurait pu privilégier une politique d'éradication du protestantisme.
Il choisit au contraire une approche pragmatique qui préserve la liberté de conscience tout en éliminant les structures politiques parallèles.
Cette conception novatrice de la politique, détachée des considérations purement confessionnelles, préfigure la modernité étatique européenne.
Troisièmement, la chute de La Rochelle bouleverse l'équilibre des forces sur l'échiquier européen.
La
défaite
des
protestants
français
affaiblit
considérablement
l'influence
anglaise
sur
le
continent
et
permet
à
Richelieu
de
réorienter
sa
politique
étrangère
vers la lutte contre l'hégémonie des Habsbourg.
Paradoxalement,
cette
victoire
sur
un
bastion
protestant
sera
suivie
par
l'entrée
de
la
France
catholique
dans
la
guerre
de
Trente
Ans...
aux
côtés
des
puissances
protestantes
contre
l'Espagne catholique.
Ce
retournement
spectaculaire
illustre
l'émergence
d'une
diplomatie
guidée
par
les
intérêts
nationaux plutôt que par les solidarités confessionnelles.
Quatrièmement,
le
siège
de
La
Rochelle
marque
une
étape
significative
dans
l'évolution
des
techniques militaires.
La
digue
maritime
conçue
par
Richelieu
représente
une
prouesse
d'ingénierie
sans
précédent
qui
impressionne toute l'Europe.
Le
blocus
combiné
"terre-mer"
mis
en
place
autour
de
la
ville
témoigne
d'une
nouvelle
approche
de la guerre de siège, privilégiant l'asphyxie progressive à l'assaut frontal.
Ces innovations influenceront durablement l'art militaire européen.
Enfin, pour Richelieu personnellement, le succès du siège de La Rochelle représente l'acte fondateur de son ministère.
Cette victoire éclatante lui confère un prestige immense et consolide durablement sa position auprès de Louis XIII.
Elle
lui
permet
d'engager
ensuite
les
réformes
profondes
qui
transformeront
les
structures
du
royaume
:
renforcement
de
l'administration
monarchique
avec
l'institution des intendants, création des premières académies royales, réorganisation fiscale et militaire.
L'État
moderne
français,
centralisé
et
bureaucratique,
trouve
ainsi
ses
racines
dans
cette
victoire
militaire
qui,
bien
au-delà
de
sa
dimension
confessionnelle,
a ouvert la voie à un nouveau modèle politique qui influencera toute l'Europe.
Ce siège qui a débuté le 10 septembre 1627 jusqu’au 28 octobre 1628, entraînera la mort de 19 000 Rochelais.
En mémoire de cet évènement, l'entrée du port de La Rochelle est matérialisée par la bouée Richelieu.